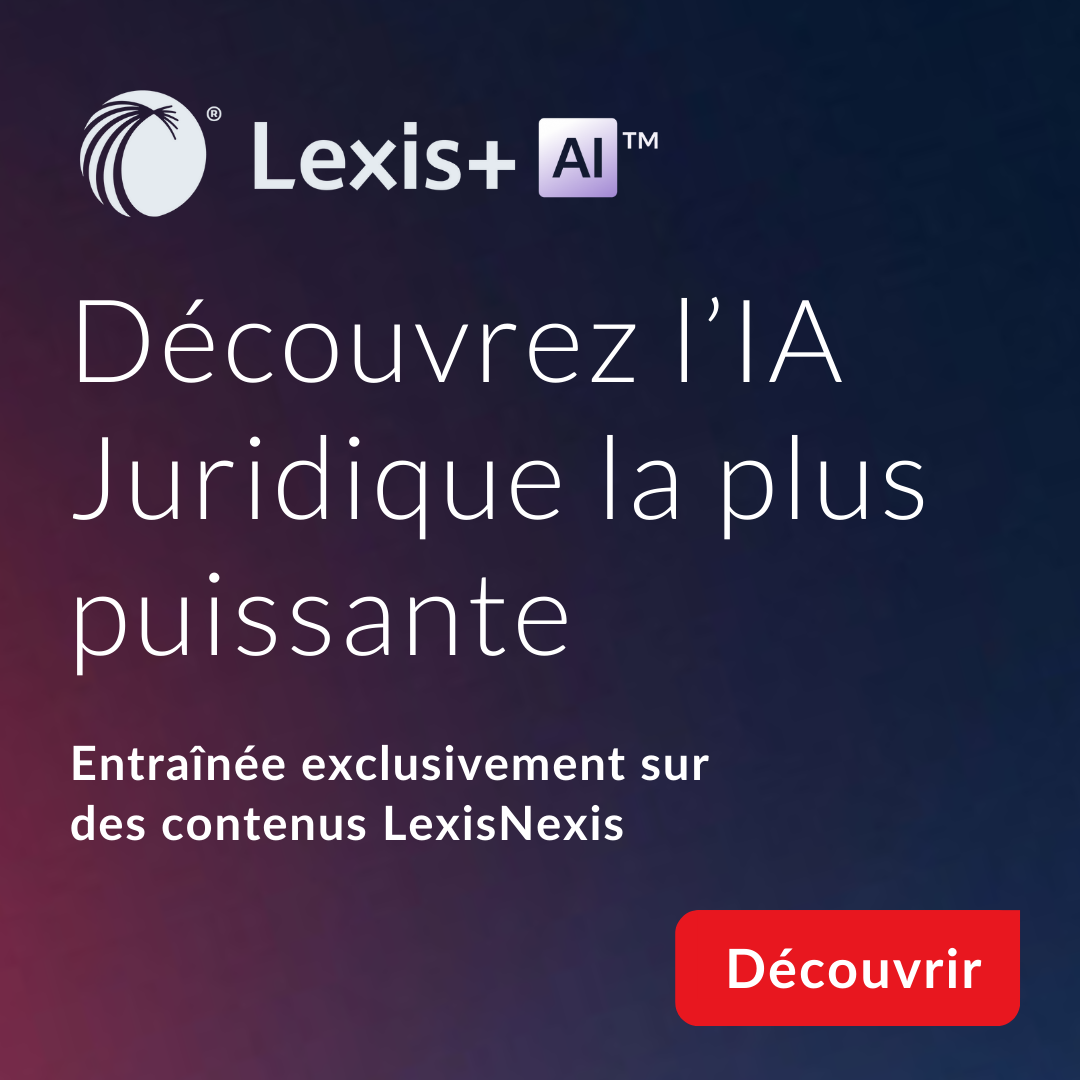A la une
Lexis+ : la nouvelle génération de recherche juridique
Face à la complexité croissante du droit et à l’accélération des évolutions législatives et jurisprudentielles, disposer d’outils performants pour mener ses recherches juridiques est plus que jamais essentiel...
Le droit de se taire lors des visites domiciliaires de l'AMF...
Certains arrêts du Conseil constitutionnel posent des limites aux articles de loi qu'ils ne sanctionnent pas. L'arrêt rendu le 21 mars 2025 est de cette espèce ( Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128...
La revanche de Liberty Valance - Édito par Laurent Vallée
Donald Trump est le nouveau shérif et, alors qu'il travaille pour les nouveaux barons du bétail des plaines numériques, il faut revoir « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford. Ransom Stoddard...
La part « politique » d'un jugement - Édito par Denis Salas
À la suite de la condamnation de Marine Le Pen et de membres du RN, la thèse d'un « jugement politique » se répand de plus en plus. L'objection mérite examen et suppose de lire de près la motivation de...
Name and Shame 2.0 : un enjeu juridique et réputationnel majeur...
Au sein du droit répressif, c'est-à-dire dans le domaine du droit pénal mais aussi des sanctions administratives, la pratique du « name and shame » occupe une place singulière. Consistant à dénoncer nommément...

À la suite de la condamnation de Marine Le Pen et de membres du RN, la thèse d'un « jugement politique » se répand de plus en plus. L'objection mérite examen et suppose de lire de près la motivation de cette décision. Elle est d'abord le fruit d'une volonté du législateur sans cesse accrue depuis les années 1980 de préciser les frontières morales de l'action politique. Dernièrement, c'est la loi « Sapin II » (en 2016, lors du quinquennat Hollande) et la loi « confiance dans la vie politique » (en 2017, lors du premier quinquennat Macron) qui ont rendu obligatoires les peines d'inéligibilité en cas d'atteinte à la probité des responsables politiques même si les juges peuvent les moduler. Ces réformes transpartisanes affirment que l'éthique politique n'est plus du seul ressort des élus, qu'ils ne peuvent être « jugés » que devant leurs électeurs, qu'ils doivent désormais comme tout citoyen répondre de leurs actes devant la justice. Non seulement les responsables politiques sont de nouveaux justiciables mais leur profession elle-même est devenue une profession comme une autre.
La loi distingue deux types de mandats : les élus titulaires de mandats locaux déclarés inéligibles par un jugement sont immédiatement déchus de leurs fonctions par le préfet même s'ils peuvent déposer un recours devant le juge administratif. Ceux qui ont un mandat national en cours sont au contraire maintenus en fonction, écrit le Conseil constitutionnel qui privilégie pour eux le principe d'éligibilité (Cons. const., 28 mars 2025, 2025-1129 QPC).
Mais ils ne peuvent pas se déclarer candidats à une élection pendant la durée de leur inéligibilité fixée par le jugement (5 ans dans le cas de M. Le Pen). Si celui-ci est assorti d'une exécution provisoire, cette inéligibilité est immédiate même en cas d'appel. Ce choix qui prive les prévenus d'un recours suppose certaines conditions : il faut, note le Conseil, que les droits de la défense soient respectés et que l'exécution immédiate ne porte pas une « atteinte disproportionnée aux mandats électifs ». Le Conseil écrit que le principe d'éligibilité garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (le droit à concourir au suffrage universel) doit être respecté. Il invite le juge à opérer un raisonnement proportionnel entre « l'atteinte à la liberté de l'électeur » et son appréciation sur les faits.
Dans son délibéré, le tribunal a estimé que la prévention de la récidive rendait nécessaire l'exécution provisoire compte tenu du système de défense du RN fondé sur la négation de toute responsabilité dans la fraude. « Nous sommes innocents ! » ont répété tous les prévenus malgré les multiples preuves qu'on leur présentait en audience publique. Comment ne pas en déduire que les pratiques frauduleuses se poursuivront dans l'avenir ? Qu'en raison des lenteurs de la justice, soit élue à l'élection présidentielle une candidate frappée d'inéligibilité pour détournement de fonds publics en première instance ? Il en résulterait un « trouble à l'ordre public démocratique ».
Ce raisonnement conséquencialiste, même s'il n'est qu'une partie de l'argumentation, signifie que le juge veut éviter les conséquences négatives de sa décision sur la vie démocratique. Il veut tenir compte de l'intention du législateur mais aussi des effets de ses décisions. Ce qu'on peut appeler la « part politique » de l'acte de juger. D'où ces « policy considerations » qu'on voit souvent dans les juridictions de common law mais qui ne sont pas habituelles dans notre pays. Au-delà de la dimension formelle du jugement, le juge assume ouvertement son rôle dans la démocratie.
Edito à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #14
Contacter LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires