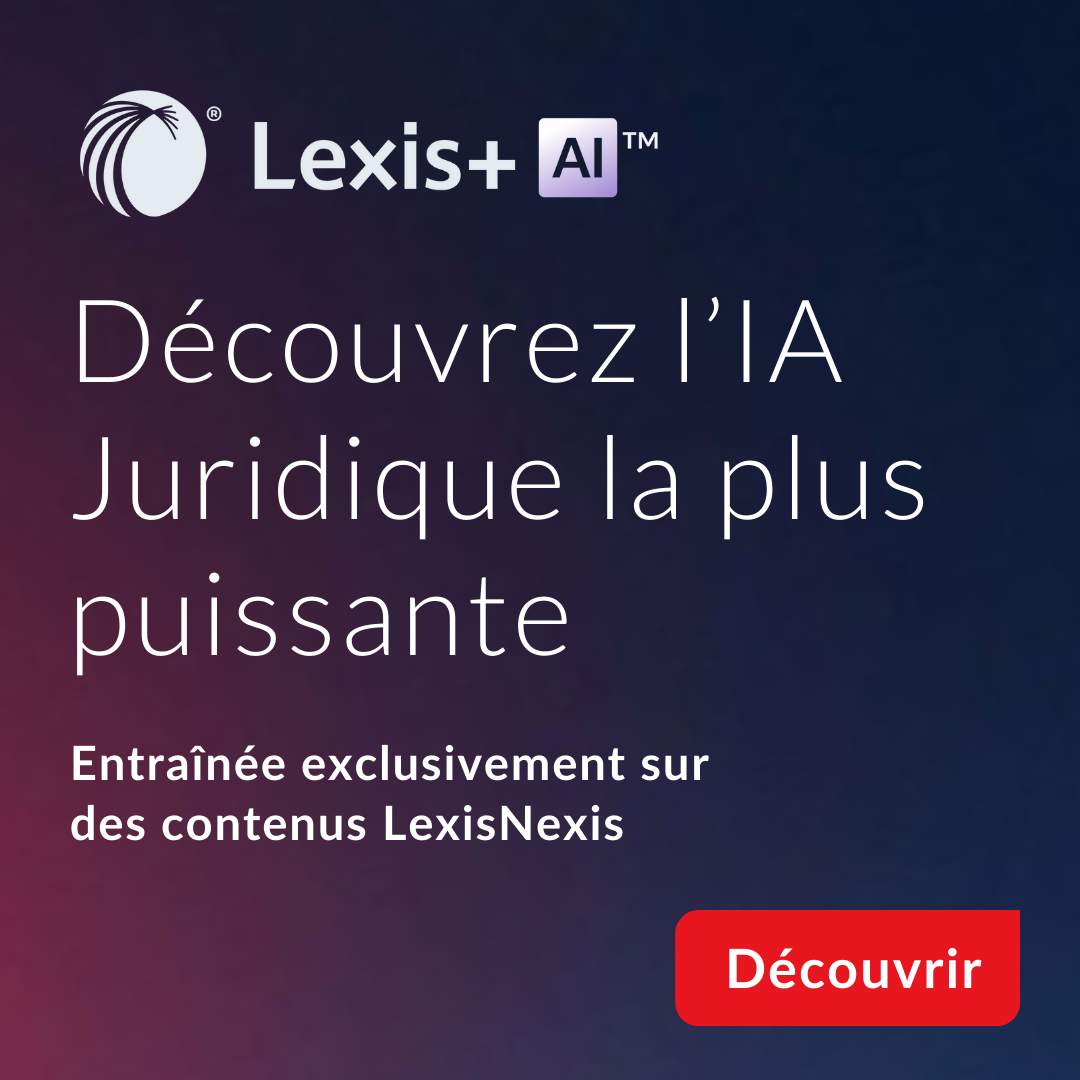A la une
Lexis+ : la nouvelle génération de recherche juridique
Face à la complexité croissante du droit et à l’accélération des évolutions législatives et jurisprudentielles, disposer d’outils performants pour mener ses recherches juridiques est plus que jamais essentiel...
Le droit de se taire lors des visites domiciliaires de l'AMF...
Certains arrêts du Conseil constitutionnel posent des limites aux articles de loi qu'ils ne sanctionnent pas. L'arrêt rendu le 21 mars 2025 est de cette espèce ( Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128...
La revanche de Liberty Valance - Édito par Laurent Vallée
Donald Trump est le nouveau shérif et, alors qu'il travaille pour les nouveaux barons du bétail des plaines numériques, il faut revoir « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford. Ransom Stoddard...
La part « politique » d'un jugement - Édito par Denis Salas
À la suite de la condamnation de Marine Le Pen et de membres du RN, la thèse d'un « jugement politique » se répand de plus en plus. L'objection mérite examen et suppose de lire de près la motivation de...
Name and Shame 2.0 : un enjeu juridique et réputationnel majeur...
Au sein du droit répressif, c'est-à-dire dans le domaine du droit pénal mais aussi des sanctions administratives, la pratique du « name and shame » occupe une place singulière. Consistant à dénoncer nommément...

Au sein du droit répressif, c'est-à-dire dans le domaine du droit pénal mais aussi des sanctions administratives, la pratique du « name and shame » occupe une place singulière. Consistant à dénoncer nommément et publiquement, sur différents supports (presse écrite, réseaux sociaux, sites Internet etc.), les manquements d'une entreprise avec l'objectif de la couvrir de honte, cette pratique d'origine anglo-saxonne n'est pas nouvelle en France mais voit son recours se généraliser dans de nombreuses législations (droit du travail, consommation, concurrence, etc.) et se développer en dehors du cadre judiciaire. Ses conséquences néfastes sont par ailleurs accentuées par les supports de publication aujourd'*** très largement numériques, qui assurent à la diffusion de l'information un caractère pérenne.
Un tel développement n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés juridiques pour les entreprises concernées. Il en va ainsi en particulier du « name and shame » appliqué par la DGCCRF dans le cadre de procédures d'injonction en matière de droit de la consommation ou des pratiques restrictives de concurrence.
En effet, contrairement à une pratique traditionnelle du « name and shame » consistant à faire la publicité d'une sanction déjà prononcée par un juge (en matière correctionnelle ou commerciale) ou au moins par une autorité administrative indépendante (que l'on songe aux sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence ou la CNIL), ou éventuellement par la DGCCRF elle-même (sanction pour méconnaissance des délais de paiement), la loi « pouvoir d'achat » d'août 2022 (L. n° 2022-1158, 16 août 2022) permet une dénonciation des entreprises à un stade antérieur à la sanction. En effet l'administration peut aujourd'*** prévoir une mesure de publication dès le stade de l'injonction, soit avant même que le délai dont l'entreprise dispose pour se mettre en conformité ait expiré.
En pratique, depuis 2022, le « name and shame » administratif s'est mué en outil de pression sur les entreprises à la disposition de l'administration : si elles ne veulent pas être livrées au tribunal médiatique dès le stade de l'injonction, les entreprises sont incitées à anticiper une « mise en conformité » pendant la période dévolue à la présentation de leurs observations (et même si elles estiment être en conformité avec la loi).
Forme de sanction « avant dire-droit » aux conditions de mise en œuvre très larges (le contenu, les supports et la durée de la mesure de publication sont laissés à la discrétion de l'administration, V. D. n° 2022-1701, 29 déc. 2022) et au caractère viral et irréversible (particulièrement quand la diffusion est faite sur Internet), le « name and shame 2.0 » devient de fait un enjeu majeur pour les entreprises. Il n'est pas rare que les entreprises redoutent davantage la publication, aux conséquences économiques aléatoires, que la sanction pécuniaire (ce qui renverse d'ailleurs la perspective, la publication étant en principe l'accessoire de la sanction principale).
Si la jurisprudence reconnaît généralement le caractère punitif des mesures de publication, leur encadrement concret par les principes généraux que sont la personnalité des peines et la proportionnalité des sanctions reste incertain à ce jour si l'on admet que le « name and shame » relève exclusivement d'une décision de l'administration. Dans ces conditions, un contrôle plus serré du juge, notamment de celui du référé-suspension en cas d'urgence, sur la nécessité et proportionnalité des publications (par exemple sur leur contenu ou les supports) constituerait un élément de sécurisation important pour les entreprises.
Plus largement, pourquoi ne pas inscrire dans les textes un « name and shame » en miroir, pesant sur l'administration, lorsque la mesure d'injonction ou de sanction est annulée, en écho avec ce que le tribunal administratif de Versailles a récemment jugé dans une décision du 12 décembre 2024 (TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2208283) ? Dans tous les cas, même à droit constant, l'expérience démontre qu'une contestation étayée et ciblée des mesures de « name and shame 2.0 » envisagées au stade de la pré-injonction peut permettre aux entreprises de faire valoir leurs intérêts.
Veille à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #14
Contacter LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires