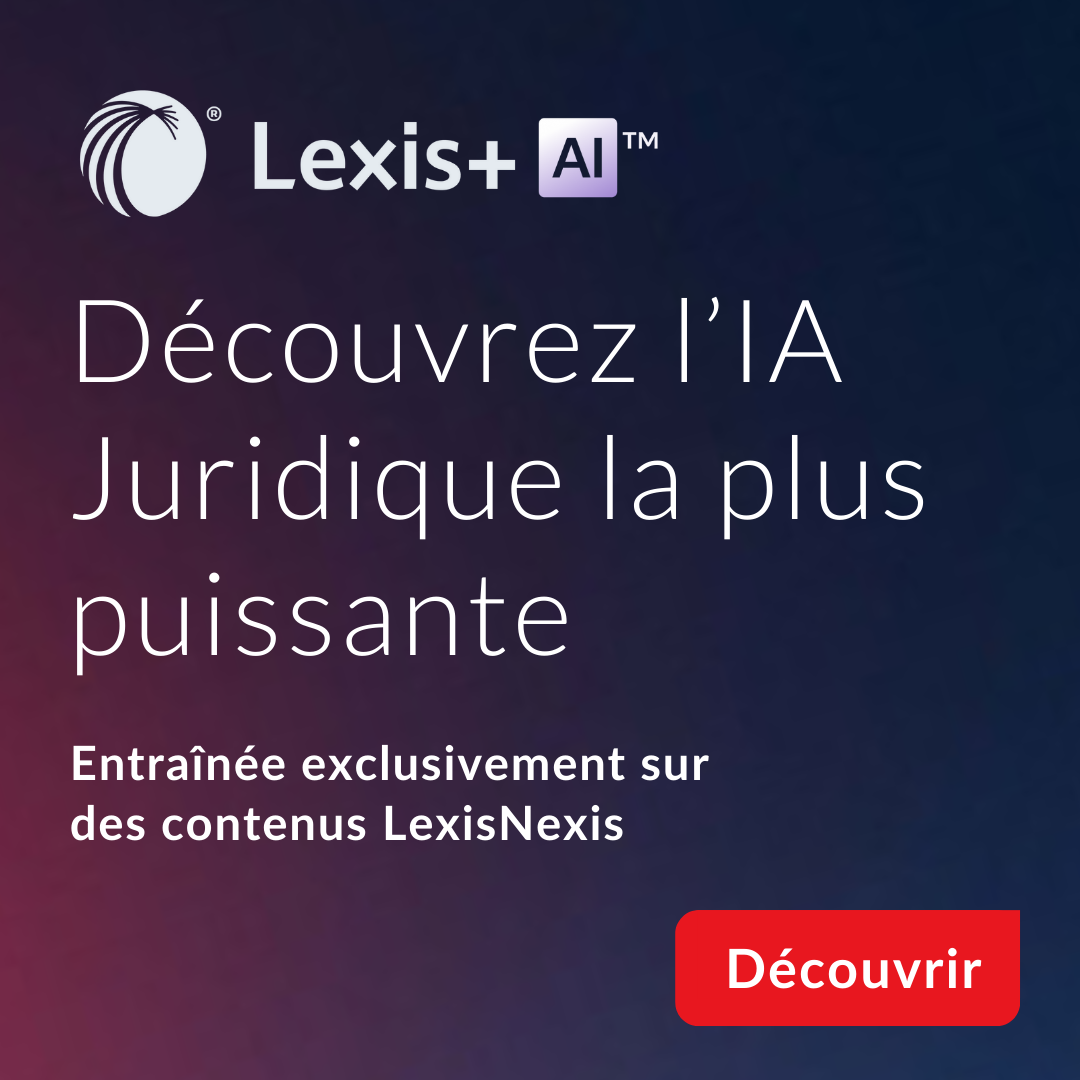A la une
Lexis+ : la nouvelle génération de recherche juridique
Face à la complexité croissante du droit et à l’accélération des évolutions législatives et jurisprudentielles, disposer d’outils performants pour mener ses recherches juridiques est plus que jamais essentiel...
Le droit de se taire lors des visites domiciliaires de l'AMF...
Certains arrêts du Conseil constitutionnel posent des limites aux articles de loi qu'ils ne sanctionnent pas. L'arrêt rendu le 21 mars 2025 est de cette espèce ( Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128...
La revanche de Liberty Valance - Édito par Laurent Vallée
Donald Trump est le nouveau shérif et, alors qu'il travaille pour les nouveaux barons du bétail des plaines numériques, il faut revoir « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford. Ransom Stoddard...
La part « politique » d'un jugement - Édito par Denis Salas
À la suite de la condamnation de Marine Le Pen et de membres du RN, la thèse d'un « jugement politique » se répand de plus en plus. L'objection mérite examen et suppose de lire de près la motivation de...
Name and Shame 2.0 : un enjeu juridique et réputationnel majeur...
Au sein du droit répressif, c'est-à-dire dans le domaine du droit pénal mais aussi des sanctions administratives, la pratique du « name and shame » occupe une place singulière. Consistant à dénoncer nommément...

Dans les tourments de ces derniers jours, cette jurisprudence de la Cour de cassation qui reconnaît le lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger et son parent d'intention, même en l'absence de lien biologique. Face à elle, en regard en quelque sorte, le procès Palmade, et cet accident dont une femme ressortira en ayant perdu l'enfant qu'elle portait depuis six mois. D'un côté, l'envie, le désir, le besoin d'enfant, qui frappe bruyamment à la porte de la Cour et se fait entendre : un « droit à l'enfant », dit-on même plus loin dans nos colonnes (JCP G 2024, act. 1410, Libres propos L. d'Avout), pour ces « autrui » qui ne peuvent donner la vie. De l'autre, le silence et l'absence de cet enfant en qui le droit ne voit précisément personne, en tout cas pas cet « autrui » qu'impose l'article 221-6 du Code pénal pour retenir la qualification d'homicide involontaire à l'encontre de celui qui l'aurait privé d'existence.
Comment admettre cependant que l'enfant in utero ne soit pas un autrui, pour n'être, comme le disaient les Romains, qu'une partie du ventre de sa mère (Infans pars viscerum matris), bref que le droit résume sa mort à une blessure de celle qui le porte ?
Un édito pourrait-il persuader de l'ineptie du refus de la qualification d'homicide auquel s'obstine la Cour de cassation ? On pointerait alors les contorsions que la solution impose. Ici, précisément, une expertise diligentée pour déterminer, avec trois sachants, si le fœtus a respiré après l'accouchement réalisé en urgence. Puisqu'il était viable, il faut rechercher s'il a été vivant, même quelques instants, car la poursuite pénale s'en trouverait changée. Le rythme cardiaque observé dans les dernières minutes de grossesse était trop faible, concluront les experts, pour estimer que l'enfant a été, ne serait-ce que le temps d'un souffle, vivant. Eût-il respiré et la peine encourue n'aurait donc pas été la même (Cass. crim., 2 déc. 2003) : c'est tout simplement absurde.
On pointerait aussi ces évolutions législatives qui se veulent compassionnelles, mais, attention, revendiquent n'être que « symboliques » : la consécration d'un acte d'enfant sans vie dans la loi du 8 janvier 1993, puis la reconnaissance du droit des parents de pouvoir choisir un prénom (Circ. 19 juin 2009), ou encore celui d'organiser des funérailles, etc. Un nom de famille ? La circulaire de 2009 l'avait exclu car, justifia-t-elle, il constitue l'un des « attributs de la personnalité juridique ». Un nom tout de même affirmera l'article unique de la loi du 6 décembre 2021 visant à « nommer » les enfants nés sans vie. Mais qu'on se le dise : « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique ». Une clause de non-droit dans la loi. La formule est inscrite dans l'article 79-1 du Code civil, peut-on le croire ?
On ne saurait désormais s'en tenir à cet « accompagnement bienveillant du droit » qui vise à favoriser la « reconnaissance mémorielle de l'enfant » et encore moins admettre que le droit s'ingénie à donner à l'enfant « l'apparence d'une existence juridique » (Sénat, rapp. n° 654, 2021).
L'OMS définit les seuils de viabilité du fœtus, ceux à partir duquel il aurait pu, précisément, ne plus être une part de sa mère. Le fait de causer sa mort est un homicide, c'est la mort d'autrui.
Edito à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #48
Contacter LexisNexis
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires